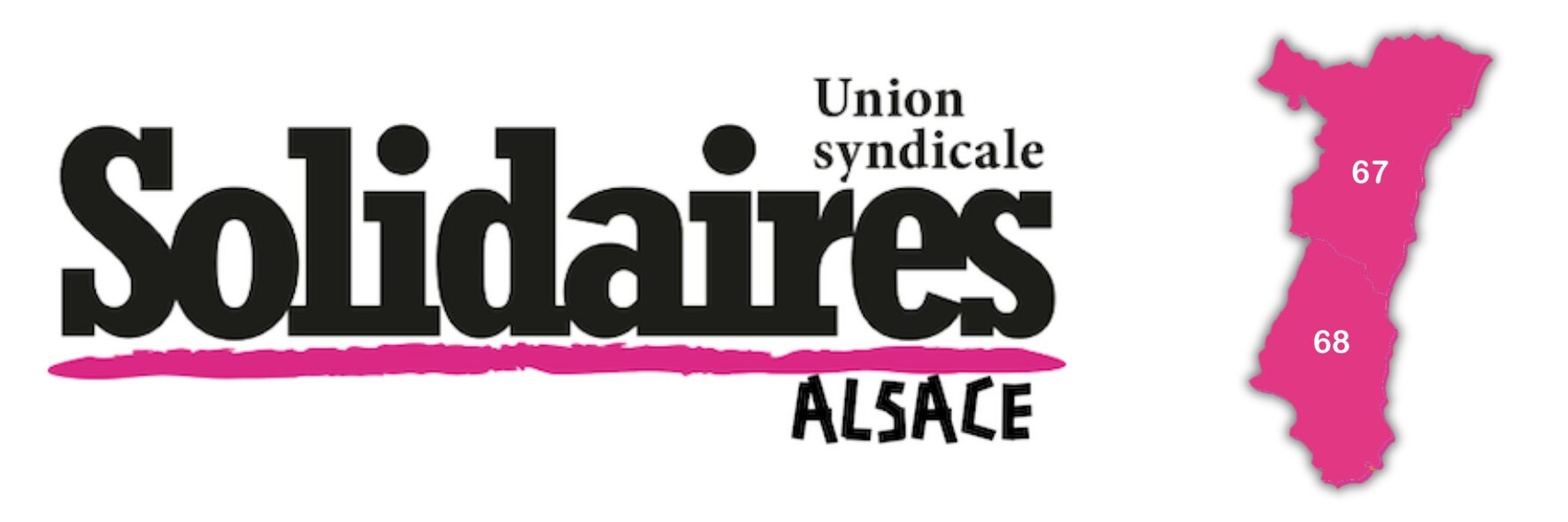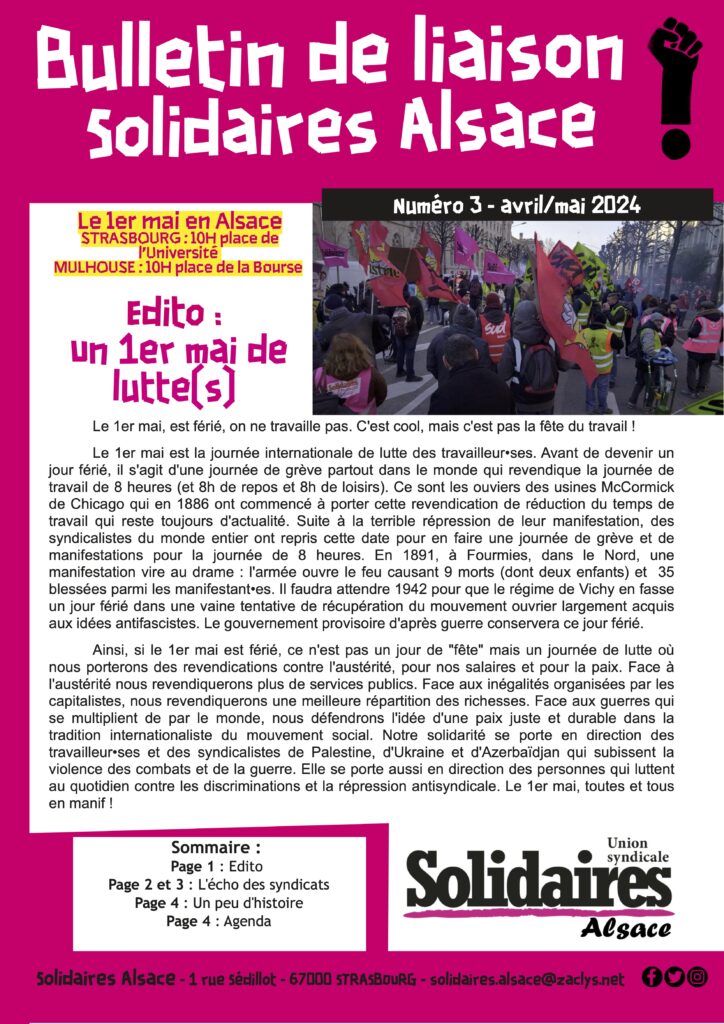Numéro 3 – avril-mai 2024
Edito : un 1er mai de lutte(s)
Le 1er mai, est férié, on ne travaille pas. C’est cool, mais c’est pas la fête du travail ! Le 1er mai est la journée internationale de lutte des travailleur•ses. Avant de devenir un jour férié, il s’agit d’une journée de grève partout dans le monde qui revendique la journée de travail de 8 heures (et 8h de repos et 8h de loisirs). Ce sont les ouviers des usines McCormick de Chicago qui en 1886 ont commencé à porter cette revendication de réduction du temps de travail qui reste toujours d’actualité. Suite à la terrible répression de leur manifestation, des syndicalistes du monde entier ont repris cette date pour en faire une journée de grève et de manifestations pour la journée de 8 heures. En 1891, à Fourmies, dans le Nord, une manifestation vire au drame : l’armée ouvre le feu causant 9 morts (dont deux enfants) et 35 blessées parmi les manifestant•es. Il faudra attendre 1942 pour que le régime de Vichy en fasse un jour férié dans une vaine tentative de récupération du mouvement ouvrier largement acquis aux idées antifascistes. Le gouvernement provisoire d’après guerre conservera ce jour férié.
Ainsi, si le 1er mai est férié, ce n’est pas un jour de « fête » mais un journée de lutte où nous porterons des revendications contre l’austérité, pour nos salaires et pour la paix. Face à l’austérité nous revendiquerons plus de services publics. Face aux inégalités organisées par les capitalistes, nous revendiquerons une meilleure répartition des richesses. Face aux guerres qui se multiplient de par le monde, nous défendrons l’idée d’une paix juste et durable dans la tradition internationaliste du mouvement social. Notre solidarité se porte en direction des travailleur•ses et des syndicalistes de Palestine, d’Ukraine et d’Azerbaïdjan qui subissent la violence des combats et de la guerre. Elle se porte aussi en direction des personnes qui luttent au quotidien contre les discriminations et la répression antisyndicale. Le 1er mai, toutes et tous en manif !
L’écho des syndicats
Quand Sud Rail dénonce des violences sexistes et sexuelles, la SNCF déraille !
Le 16 avril, près de 350 cheminot•es, dont une très forte représentation de Sud Rail, se sont réuni•es à la direction régionale de la SNCF à Strasbourg afin de soutenir Régis, convoqué en conseil de discipline dans ce qui représente un nouveau cas de répression antisyndicale à la SNCF. A l’origine de cette affaire, des violences sexistes et sexuelles au travail que la SNCF n’a pas voulu reconnaitre.
Comme souvent en matière de violences sexistes et sexuelles, c’est la double peine pour les victimes. Au poids de l’agression et de ses conséquences, s’ajoute le rouleau compresseur de l’employeur qui a choisi de ne pas la croire et de retourner la responsabilité de l’agression contre elle. Ainsi, c’est pour avoir dénoncé plusieurs agressions à caractère sexuel subies sur son lieu de travail que Marion a été santionnée. La SNCF a décidé de ne pas la croire malgré la présence d’un témoin, Régis, cheminot et délégué Sud Rail dans la gare de Haguenau.
Comble du cynisme pour la SNCF, c’est le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes et contre les violences sexistes et sexuelles, que Marion a réceptionné un courrier la convoquant à un entretien préalable pour sanction. Cette sanction est prononcée le 15 avril : plusieurs jours de suspension de salaire et surtout un dernier avertissement avant la radiation donc le licenciement. Une bonne manière pour la SNCF de taire les violences faites aux femmes !
Comme souvent, le discours d’égalité de genre n’est une façade pour de nombreux employeurs. Derrière, se cache une toute autre réalité : le refus de prendre ses responsabilités et faire taire les syndicalistes combatif•ves.
Ainsi, elle se saisit de cette affaire pour exercer une véritable répression antisyndicale à l’encontre de Régis, témoin des faits, et délégué syndical Sud Rail Alsace dans la gare de Haguenau à qui la direction SNCF Grand-Est reproche d’être trop actif. En témoigne son dossier : sur 600 pages, plus de 550 concernent des faits syndicaux. La direction régionale TER veut lui faire payer la mise en échec d’un projet de restructuration de services.
A travers Régis, ce sont les syndicalistes de lutte qu’on attaque, ceux et celles qui se tiennent aux côtés des travailleur•ses et qui permettent collectivement de relever la tête face à la domination patronale.
Solidaires Alsace exige l’abandon de toute sanction à l’encontre de Marion et Régis et l’ouverture d’une véritable enquête sur la base des accusations portées par Marion. Il est temps que les capitalistes cessent d’instrumentaliser l’égalité de genre qu’ils sont incapables de défendre et de mettre en place !
Solidaires Alsace
Sud éducation : contre le choc des savoirs, le SNU et l’uniforme.
Pour une école publique émancipatrice !
Le jeudi 1er février, plus de 2000 personnels de l’éducation nationale ont manifesté leur colère en Alsace contre la politique antisociale du Ministère de l’Education. La grève était majoritaire dans un certain nombre d’établissements et d’écoles, et bien suivie dans d’autres. Les personnels, notamment ceux et celles qui enseignent en collège sont engagé•es dans une lutte contre le choc de savoirs. De quel choc parle-t-on ?
Le choc des savoirs est une série de mesures décidées par Gabriel Attal quand il était encore Ministre de l’Education. En décembre 2023, il annonce des mesures pour relever le niveau des élèves en mathématiques et en français. Il s’agit de renforcer la maitrise des savoirs dits « fondamentaux » (lire, écrire, compter… et savoir bien obéir au patron !).
Dans la droite ligne réactionnaire et libérale de ses prédécesseurs au Ministère de l’Education nationale, Attal a donc décidé :
- de faire labelliser des manuels par le ministère (contre la liberté pédagogique des enseignant•es) ;
- de réécrire les programmes de la manternelle à la terminale ;
- de rendre le brevet obligatoire pour accéder au lycée et de rétablir le redoublement.
La mesure phare de ce programme reste toutefois la mise en place des groupes de niveau au collège en mathématiques et en français. Les bons avec les bons, les élèves en difficulté avec les élèves en difficulté. Aux un•es, les activités pédagogiques stimulantes, aux autres, les tâches simples et répétitives. On retrouve ainsi, appliquée à des collégien•nes, la division du travail telle qu’on la connait dans de nombreuses entreprises entre patrons, contremaitres et travailleur•ses qui exécutent. Comme dans le monde du travail capitaliste, il y aura peu de perspectives d’évolutions pour les élèves classés dans les groupes en difficulté. Cela ne fera que renforcer les inégalités existantes et assigner une position sociale à chaque jeune au lieu de réduire les inégalités.
Ce choc des savoirs s’accompagne d’un retour de l’uniforme. Sensé lutter contre les inégalités, ce dernier ne fera que les cacher au lieu de les réduire. De plus, cet uniforme ressemble très fortement à celui porté lors des stages SNU (Service national universel encadré entre autres par l’armée) que le gouvernement entend imposer à tous les élèves de seconde qui n’auront pas su activer leurs réseaux afin de trouver un stage de fin d’année devenu obligatoire. Selon les plans du gouvernement, le SNU sera généralisé en 2026. Le gouvernement se radicalise donc contre la jeunesse, notamment celle des classes populaires qui s’est révoltée suite à la mort de Nahel, et qu’il entend mettre au pas pour en faire de la chair à patron et de la chair à canon.
Les solutions ne manquent pas puisque les organisations syndicales et en particulier Sud éducation, ne cessent de revendiquer des moyens pour permettre à l’Ecole d’assurer les missions qu’on lui confie. Cela ne doit pas nous faire oublier que la lutte pour une école publique coopérative et émancipatrice, qui lutte contre les discriminations et la compétition des un•es contre les autres et qui participe à la transformation écologique et sociale de la société reste plus que jamais d’actualité.
Sud éducation Alsace
Un peu d’histoire
1er mai en Alsace : le courage des ouvriers et ouvrières
Dès la fin du XIXème siècle, en Alsace, les manifs du 1er mai se sont préparées en amont dans les bistrots. Malgré toutes les précautions pour éviter les fuites, les rapports de police (mentionnant les noms des « meneurs ») sont nombreux. Toute manifestation était surveillée de près, réprimée même. Avant le Front populaire, en 1934-35, la police était postée aux abords des usines, de manière à dissuader les militants et militantes qui s’apprêtaient à réclamer le raccourcissement de la durée du travail pour tous, hommes, femmes, enfants, et la journée de 8h…
Le Parti communiste et la CGT furent à l’origine de nombreuses initiatives de manifestations. Celles-ci ne se déroulaient que sous conditions strictes. Par exemple, en 1922 la police municipale de Strasbourg (*) ne donna son autorisation que sous les conditions suivantes : « Les bannières ou drapeaux rouges devront porter des inscriptions corporatives » (corporations de métiers). « Les pancartes ne pourront porter aucune inscription séditieuse ou injurieuse pour le gouvernement ».« Les chants et cris séditieux ou injurieux sont également prohibés ».
Et, pour couronner le tout : « Le comité de l’Union locale (organisateur de l’action) veillera au maintien du bon ordre du cortège. »
Dans ces conditions, où chacun était fiché par la police (les noms figurent noir sur blanc dans les rapports), et où l’on craignait donc de perdre son emploi, on imagine aisément quel courage il a fallu à ces hommes et femmes des classes laborieuses, soumis à des cadences infernales, pour défiler dans les rues sous le regard désapprobateur des bourgeois ! Le nombre d’ouvriers et d’ouvrières qui osaient faire grève ou prendre un jour de congé le 1er mai était donc très variable. A Strasbourg, de quelques centaines à 12 000 en 1937.
(*) Lettre du Directeur des services de police de Strasbourg-ville à M. le président de l’Union locale, 25 avril 1922.